|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Gautama ne désirait pas rester mais partir
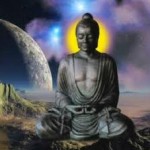 Un ami me disait un jour que Gautama, le Bouddha historique, devait avoir consenti à faire un bien grand sacrifice en quittant sa femme et son enfant, encore bébé, pour aller s’immerger ainsi dans la méditation, afin d’atteindre l’Illumination. C’est du moins ce que nous raconte l’histoire de Gautama, dans sa version la plus officielle qui soit. À cette affirmation, j’ai alors répondu par la négative, ce qui a fortement intrigué cet ami d’alors. J’ai répondu que je doutais fort que Gautama ait été obligé de « sacrifier » quoique ce soit, puisque désirant partir pour sa propre Illumination, il est finalement parti ! Le sacrifice, à mon sens, aurait été pour lui de rester et plutôt que femme et enfant, d’abandonner sa Quête spirituelle. Bien sûr, mon ami, quelque peu interloqué mais sachant que je n’affirmais rien gratuitement ou juste pour le plaisir de contrarier, me pressa de m’expliquer plus avant, d’étayer un peu mieux mon propos. Et c’est ce que j’ai fait. Au-delà même de ses attentes et d’ailleurs, du sujet de départ.
Un ami me disait un jour que Gautama, le Bouddha historique, devait avoir consenti à faire un bien grand sacrifice en quittant sa femme et son enfant, encore bébé, pour aller s’immerger ainsi dans la méditation, afin d’atteindre l’Illumination. C’est du moins ce que nous raconte l’histoire de Gautama, dans sa version la plus officielle qui soit. À cette affirmation, j’ai alors répondu par la négative, ce qui a fortement intrigué cet ami d’alors. J’ai répondu que je doutais fort que Gautama ait été obligé de « sacrifier » quoique ce soit, puisque désirant partir pour sa propre Illumination, il est finalement parti ! Le sacrifice, à mon sens, aurait été pour lui de rester et plutôt que femme et enfant, d’abandonner sa Quête spirituelle. Bien sûr, mon ami, quelque peu interloqué mais sachant que je n’affirmais rien gratuitement ou juste pour le plaisir de contrarier, me pressa de m’expliquer plus avant, d’étayer un peu mieux mon propos. Et c’est ce que j’ai fait. Au-delà même de ses attentes et d’ailleurs, du sujet de départ.
 On part de la prémisse ou du principe établi que le Bouddha était persuadé que « le désir est à l’origine de la souffrance. » Voire de toutes souffrances. Pourtant, un désir puissant brûlait le cœur du çakyamuni (le sage du clan des çakya ou shakya) : celui de percer les mystères de la vie et de la mort et, en un mot, d’accéder à la suprême sagesse. Et son désir devait nécessairement être des plus ardents pour qu’il soit capable de tout abandonner, y compris son héritage princier. Et nous savons que le prince Siddhartha parvint effectivement à la « boddhicité », autrement dit, à la totale Lumière (racine « bod ») de la Conscience de Soi. Son désir, issu d’un but poursuivi, lui donna donc la force d’obtenir cette Sagesse et cette Lumière convoitées. Il est dit par ailleurs que le Bouddha était venu en ce monde pour y faire cesser la souffrance. Ce qui est en soi un désir, à n’en pas douter. Ce ne sont donc pas les désirs qui sont à l’origine de la souffrance, mais bien l’accumulation de désirs insatisfaits ! Or, son principal désir, il a tout fait pour l’exaucer. Sa souffrance aurait été immense s’il n’y était pas parvenu avant la fin de sa vie.
On part de la prémisse ou du principe établi que le Bouddha était persuadé que « le désir est à l’origine de la souffrance. » Voire de toutes souffrances. Pourtant, un désir puissant brûlait le cœur du çakyamuni (le sage du clan des çakya ou shakya) : celui de percer les mystères de la vie et de la mort et, en un mot, d’accéder à la suprême sagesse. Et son désir devait nécessairement être des plus ardents pour qu’il soit capable de tout abandonner, y compris son héritage princier. Et nous savons que le prince Siddhartha parvint effectivement à la « boddhicité », autrement dit, à la totale Lumière (racine « bod ») de la Conscience de Soi. Son désir, issu d’un but poursuivi, lui donna donc la force d’obtenir cette Sagesse et cette Lumière convoitées. Il est dit par ailleurs que le Bouddha était venu en ce monde pour y faire cesser la souffrance. Ce qui est en soi un désir, à n’en pas douter. Ce ne sont donc pas les désirs qui sont à l’origine de la souffrance, mais bien l’accumulation de désirs insatisfaits ! Or, son principal désir, il a tout fait pour l’exaucer. Sa souffrance aurait été immense s’il n’y était pas parvenu avant la fin de sa vie.
 Ainsi, quitter femme, enfant, parents, héritage et toutes ces choses faisant partie du monde social ou matérialiste, ne consistait pas en un si grand sacrifice que cela. Bien au contraire ! Rien au monde n’aurait pu donner à Gautama, l’envie de sacrifier ce désir. Il est donc plus logique de penser que puisque sa décision fut de partir, le sacrifice aurait plutôt consisté à poursuivre une vie jugée par lui insipide et donc, de demeurer auprès des siens et dans les mêmes conditions que celles de sa naissance et d’un vécu dû à son rang. Au passage et l’air de rien, notons cette phrase issue de l’un des versets bibliques les plus connus : « Celui qui désire me suivre doit être capable d’abandonner père, mère, femme et enfants et amis… » C’est le Maître Jésus qui est censé parler ainsi, et non un quelconque acteur de second ordre.
Ainsi, quitter femme, enfant, parents, héritage et toutes ces choses faisant partie du monde social ou matérialiste, ne consistait pas en un si grand sacrifice que cela. Bien au contraire ! Rien au monde n’aurait pu donner à Gautama, l’envie de sacrifier ce désir. Il est donc plus logique de penser que puisque sa décision fut de partir, le sacrifice aurait plutôt consisté à poursuivre une vie jugée par lui insipide et donc, de demeurer auprès des siens et dans les mêmes conditions que celles de sa naissance et d’un vécu dû à son rang. Au passage et l’air de rien, notons cette phrase issue de l’un des versets bibliques les plus connus : « Celui qui désire me suivre doit être capable d’abandonner père, mère, femme et enfants et amis… » C’est le Maître Jésus qui est censé parler ainsi, et non un quelconque acteur de second ordre.
 Dans le Mahâbhârata, une des plus grandioses épopées hindoues, le Seigneur Krishna demande à Arjuna, également fils de roi (le 3e) de livrer bataille face à une armée dont les premiers rangs sont composés des membres de sa propre famille, à savoir père, mère, enfants, frères, sœurs, cousins, amis, etc. Cela ne nous rappelle t’il pas quelque chose ? Bien sûr, il s’agit là d’une allégorie et seule l’image toute mentale qu’entretient Arjuna au sujet des « liens parentaux » doit être combattue voire anéantie. Pas les véritables membres physiques de sa famille ! Malgré cela, nous trouvons une fois de plus cette idée d’abandonner non pas « les désirs » mais un seul désir en particulier : celui de satisfaire à l’image que les autres projettent sur nous ainsi qu’à celle que nous projetons sur les autres. En particuliers nos proches, parents et amis.
Dans le Mahâbhârata, une des plus grandioses épopées hindoues, le Seigneur Krishna demande à Arjuna, également fils de roi (le 3e) de livrer bataille face à une armée dont les premiers rangs sont composés des membres de sa propre famille, à savoir père, mère, enfants, frères, sœurs, cousins, amis, etc. Cela ne nous rappelle t’il pas quelque chose ? Bien sûr, il s’agit là d’une allégorie et seule l’image toute mentale qu’entretient Arjuna au sujet des « liens parentaux » doit être combattue voire anéantie. Pas les véritables membres physiques de sa famille ! Malgré cela, nous trouvons une fois de plus cette idée d’abandonner non pas « les désirs » mais un seul désir en particulier : celui de satisfaire à l’image que les autres projettent sur nous ainsi qu’à celle que nous projetons sur les autres. En particuliers nos proches, parents et amis.
 Mais que peut bien signifier cette idée de devenir capable de « quitter père, mère, femme, enfants et amis », finalement, si ce n’est de refuser de cautionner plus longtemps ces idées terribles de devoir faire passer la volonté et les désirs des autres avant les nôtres et surtout, celle devenue viscérale et consistant à satisfaire aux attentes tyranniques d’un monde ou d’une société castratrice d’individualité ? N’est-ce pas ce genre de désir qui serait le véritable responsable de la plupart de nos souffrances psychologiques ? Puisqu’il est question d’attachement, que dire de celui, parmi les plus forts, qui nous pousse (compulsion) à satisfaire les attentes d’autrui, les forçant en retour, de devoir satisfaire aux nôtres, afin que personne ne soit lésé ?
Mais que peut bien signifier cette idée de devenir capable de « quitter père, mère, femme, enfants et amis », finalement, si ce n’est de refuser de cautionner plus longtemps ces idées terribles de devoir faire passer la volonté et les désirs des autres avant les nôtres et surtout, celle devenue viscérale et consistant à satisfaire aux attentes tyranniques d’un monde ou d’une société castratrice d’individualité ? N’est-ce pas ce genre de désir qui serait le véritable responsable de la plupart de nos souffrances psychologiques ? Puisqu’il est question d’attachement, que dire de celui, parmi les plus forts, qui nous pousse (compulsion) à satisfaire les attentes d’autrui, les forçant en retour, de devoir satisfaire aux nôtres, afin que personne ne soit lésé ?
Pourquoi ne pas satisfaire nos propres attentes et laisser aux autres le soin d’en faire autant et seulement s’ils en ont envie ? Qui peut se prétendre « libre » tout en étant conduit par le devoir et donc, par cette idée terrible de « dette » ? Est-il libre celui qui suit des règles de morale plutôt que son intuition ou que ses propres idées ?
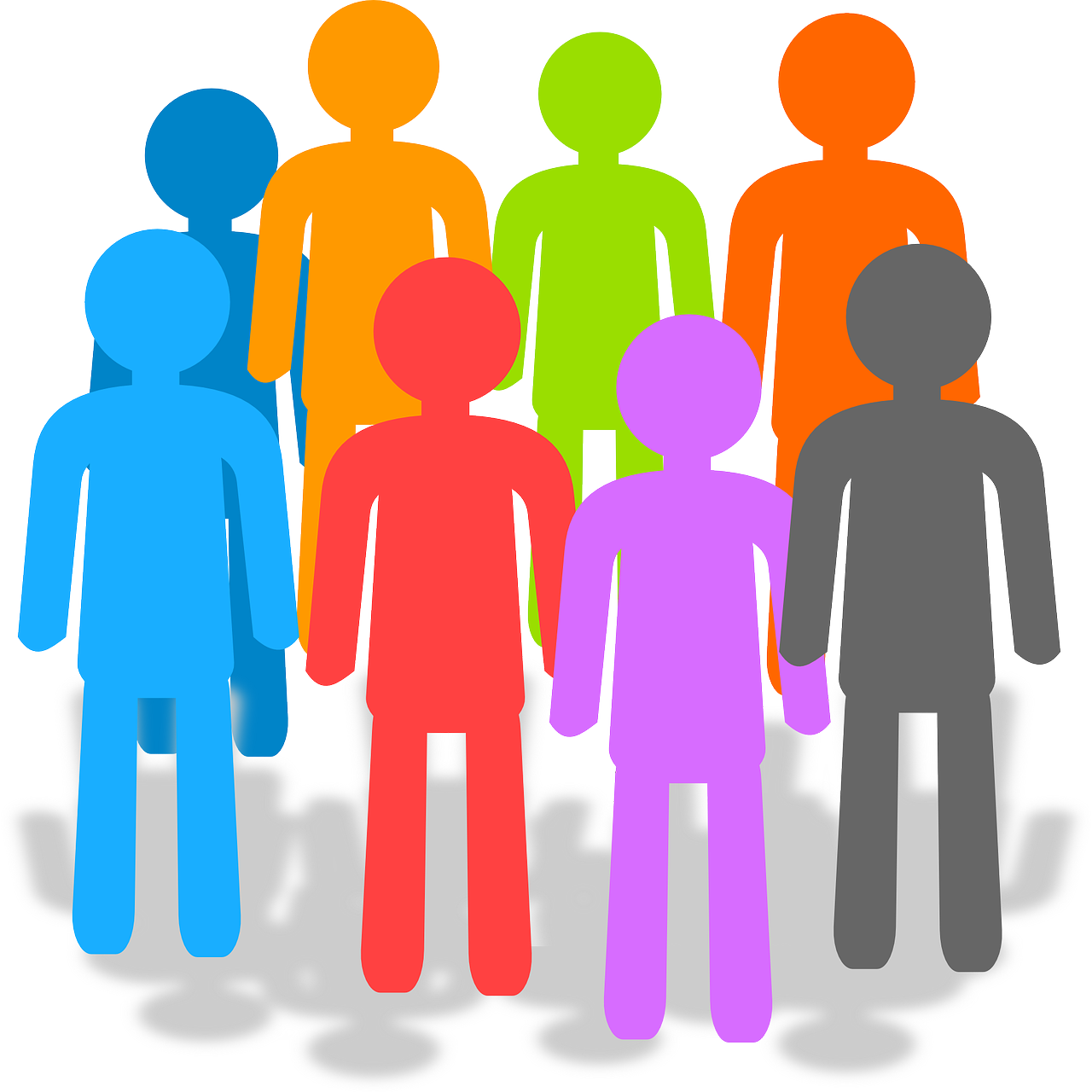 La vie de groupe nous force à satisfaire les attentes de ce groupe. Mais un groupe est composé de personnes multiples et il est peu probable de réussir à les contenter toutes, sans exception. Pourtant, il est possible d’atteindre au contentement suprême, cela en réussissant à contenter une seule et unique personne : soi-même ! Et se contenter soi est naturel, attendu qu’il est naturel de tout attendre de soi, puisque l’on se doit tout à soi-même, y compris la plus totale fidélité. Celui qui ne réussit plus à se contenter devient inapte à aimer ce qu’il vit. Et comme il est celui qui vit ce mécontentement, il en arrive très vite à ne plus aimer qui il est ou qui il manifeste.
La vie de groupe nous force à satisfaire les attentes de ce groupe. Mais un groupe est composé de personnes multiples et il est peu probable de réussir à les contenter toutes, sans exception. Pourtant, il est possible d’atteindre au contentement suprême, cela en réussissant à contenter une seule et unique personne : soi-même ! Et se contenter soi est naturel, attendu qu’il est naturel de tout attendre de soi, puisque l’on se doit tout à soi-même, y compris la plus totale fidélité. Celui qui ne réussit plus à se contenter devient inapte à aimer ce qu’il vit. Et comme il est celui qui vit ce mécontentement, il en arrive très vite à ne plus aimer qui il est ou qui il manifeste.
Alors il cesse de s’aimer lui-même. Mais comme nous avons tous besoin de ce sentiment de l’amour en soi, alors nous cherchons ce sentiment au-dehors et chez les autres.
 Nous attendons que les autres nous aiment, pour nous et à notre place, tandis que ces mêmes autres attendent la même chose de nous. Il nous faut alors réussir à aimer les autres, qu’ils soient « aimables » (dignes d’amour) ou non. Et nous attendons en retour et comme moindre politesse, que l’on réussisse à nous aimer aussi, « en l’état » (tels que nous sommes), que cela plaise ou pas. Et comme il est au moins improbable de plaire à tout le monde, certains vont nous aimer tandis que d’autres vont nous détester. Nous attendons alors de ceux qui nous détestent, qu’ils se mettent à nous aimer aussi, car nous avons toujours autant besoin, sinon plus, de sentir, en nous, ce sentiment de l’amour.
Nous attendons que les autres nous aiment, pour nous et à notre place, tandis que ces mêmes autres attendent la même chose de nous. Il nous faut alors réussir à aimer les autres, qu’ils soient « aimables » (dignes d’amour) ou non. Et nous attendons en retour et comme moindre politesse, que l’on réussisse à nous aimer aussi, « en l’état » (tels que nous sommes), que cela plaise ou pas. Et comme il est au moins improbable de plaire à tout le monde, certains vont nous aimer tandis que d’autres vont nous détester. Nous attendons alors de ceux qui nous détestent, qu’ils se mettent à nous aimer aussi, car nous avons toujours autant besoin, sinon plus, de sentir, en nous, ce sentiment de l’amour.
Mais comme les autres, ceux qui nous détestent, refusent de nous aimer « en l’état », ils nous demandent alors de changer, de ne plus être « nous » mais de ressembler à cette image idéale qu’ils ont de nous. Car cette image-là est des plus aimables, soit « digne d’amour » !
 Nous sommes dès lors obligés de devenir autre chose que ce que nous sommes, de nous trahir, en quelque sorte. Mais comme il est impossible d’être autre chose que ce que l’on est et que « ce que l’on est étant unique », nous ne parvenons pas à ne plus être nous et donc, à être quelqu’un d’autre. La seule solution est alors de faire semblant, pour donner le change et dans l’espoir d’être aimés enfin, de RESSENTIR cet amour en nous. Mais au fait, pourquoi nous ne nous aimons plus, déjà ? Ah, oui ! Parce que nous sommes obligés de « faire des efforts » en vue de correspondre aux attentes – évidemment frustrées – des autres. Alors nous cessons de faire des efforts en vue de devenir plus « aimables » et donc, digne de l’amour de ceux qui ne nous aiment pas « en l’état ».
Nous sommes dès lors obligés de devenir autre chose que ce que nous sommes, de nous trahir, en quelque sorte. Mais comme il est impossible d’être autre chose que ce que l’on est et que « ce que l’on est étant unique », nous ne parvenons pas à ne plus être nous et donc, à être quelqu’un d’autre. La seule solution est alors de faire semblant, pour donner le change et dans l’espoir d’être aimés enfin, de RESSENTIR cet amour en nous. Mais au fait, pourquoi nous ne nous aimons plus, déjà ? Ah, oui ! Parce que nous sommes obligés de « faire des efforts » en vue de correspondre aux attentes – évidemment frustrées – des autres. Alors nous cessons de faire des efforts en vue de devenir plus « aimables » et donc, digne de l’amour de ceux qui ne nous aiment pas « en l’état ».
Et comme cela est TRÈS difficile d’agir ainsi, nous faisons de nouveau des efforts, mais cette fois-ci, uniquement pour nous, pour demeurer « qui nous sommes vraiment. »
 Et là, miracle ! Ces efforts sont couronnés de succès ! En ne prêtant plus attention aux attentes d’autrui, nous recommençons à vivre vraiment et à avoir le pouvoir de satisfaire infiniment moins de désirs, puisque à présent, il n’est question que de satisfaire les nôtres, soit les désirs d’une seule et même personne. Et notre joie grandit encore lorsque nous voyons les autres, à l’extérieur, qui rêvent en secret de faire comme nous mais qui n’en ont pas le courage ni un désir encore suffisant, nous vomir leur impuissance au nez. Ils tentent par tous les moyens de nous faire admettre que nous avons tort, alors que nous SENTONS avoir pleinement raison. Ils ont beau nous condamner, nous rejeter, nous insulter et nous traiter « d’égoïstes », nous ne dérogeons pas de notre nouvelle Règle de Vie !
Et là, miracle ! Ces efforts sont couronnés de succès ! En ne prêtant plus attention aux attentes d’autrui, nous recommençons à vivre vraiment et à avoir le pouvoir de satisfaire infiniment moins de désirs, puisque à présent, il n’est question que de satisfaire les nôtres, soit les désirs d’une seule et même personne. Et notre joie grandit encore lorsque nous voyons les autres, à l’extérieur, qui rêvent en secret de faire comme nous mais qui n’en ont pas le courage ni un désir encore suffisant, nous vomir leur impuissance au nez. Ils tentent par tous les moyens de nous faire admettre que nous avons tort, alors que nous SENTONS avoir pleinement raison. Ils ont beau nous condamner, nous rejeter, nous insulter et nous traiter « d’égoïstes », nous ne dérogeons pas de notre nouvelle Règle de Vie !
 Et nous sommes fiers de réussir là où tant d’être ont échoué, échouent et échoueront encore ! Cette fierté nous donne envie d’aimer « qui nous sommes devenus » ! Alors le sentiment de l’amour en nous réapparaît et nous comprenons cette vérité transcendantale : « Si nous sommes incapables de nous aimer, personne ne le fera jamais pour nous et à notre place, car ce n’est pas de l’amour des autres dont nous avons le plus besoin, mais du SENTIMENT de la Présence de l’amour en soi. »
Et nous sommes fiers de réussir là où tant d’être ont échoué, échouent et échoueront encore ! Cette fierté nous donne envie d’aimer « qui nous sommes devenus » ! Alors le sentiment de l’amour en nous réapparaît et nous comprenons cette vérité transcendantale : « Si nous sommes incapables de nous aimer, personne ne le fera jamais pour nous et à notre place, car ce n’est pas de l’amour des autres dont nous avons le plus besoin, mais du SENTIMENT de la Présence de l’amour en soi. »
Mon ami me demanda alors ce que j’aurais répondu, à l’époque, si étant le Bouddha, on m’avait posé cette question redoutable : « Mais n’est-ce pas égoïste de ne se concentrer que sur ses propres désirs et donc, sur son seul plaisir ? » Je lui dis que j’aurais répondu ainsi : « Pour être égoïste, il faut la présence du pôle opposé, à savoir, la générosité. Je suis égoïste si mes désirs diffèrent de ceux d’une autre personne avec laquelle je partage ma vie. Mais si je partage ma vie avec une personne qui partage déjà les mêmes désirs que les miens, alors sa volonté de satisfaire ses désirs s’ajoute à ma volonté de satisfaire les miens et comme ce sont les mêmes, les désirs diminuent d’autant qu’ils s’exaucent plus vite, puisque le pouvoir de les satisfaire est multiplié par deux. »
Mon ami me promit dès lors de reconsidérer le contenu des « canons » du Bouddhisme et ce, en totalité et de manière urgente !
Serge Baccino
