|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Se taire mais pourquoi ?
(Nota : Le fameux « Tu veux en parler ? » généralement refusé.)
 Dans les films modernes, personne ne raconte les détails de ce qu’il a vécu; chacun cherche à éluder. Se faisant, le résultat est catastrophique et laisse aux autres le soin d’inventer ce qui manque pour rassurer leur « moi. » Mais pourquoi ne jamais raconter les faits tels qu’ils se sont produits ? Peur du jugement, de l’incompréhension d’autrui ou… D’une bien triste réalité ? Quelle est cette réalité si triste ? Elle est issue d’un choc émotionnel produit puis reproduit régulièrement durant l’enfance, voire plus tard et jusqu’à l’âge de jeune adulte. La plupart des gens n’ont pas peur qu’on ne les croit pas ou même que l’on se moque d’eux, car ce qu’ils vivent, en détail, n’est que rarement extraordinaire et donc, ne nécessite pas de forcer la croyance et est bien peu souvent digne de moqueries.
Dans les films modernes, personne ne raconte les détails de ce qu’il a vécu; chacun cherche à éluder. Se faisant, le résultat est catastrophique et laisse aux autres le soin d’inventer ce qui manque pour rassurer leur « moi. » Mais pourquoi ne jamais raconter les faits tels qu’ils se sont produits ? Peur du jugement, de l’incompréhension d’autrui ou… D’une bien triste réalité ? Quelle est cette réalité si triste ? Elle est issue d’un choc émotionnel produit puis reproduit régulièrement durant l’enfance, voire plus tard et jusqu’à l’âge de jeune adulte. La plupart des gens n’ont pas peur qu’on ne les croit pas ou même que l’on se moque d’eux, car ce qu’ils vivent, en détail, n’est que rarement extraordinaire et donc, ne nécessite pas de forcer la croyance et est bien peu souvent digne de moqueries.
 Pour le dire au plus simple, il est rare que notre vécu soit incroyable ou ridicule d’un bout à l’autre de la journée. Il n’est donc pas possible de mettre ce type de réaction émotive sur le compte de la peur de ne pas être cru sur parole ou sur cette autre peur de voir les autres se moquer de nous. Il y a donc forcément autre chose de caché sous ce silence maladif. Sans doute la pire chose que le subconscient se refuse de voir ressurgir. Une réalité. Cette réalité se nomme « Tout le monde se moque éperdument de ta vie, seule compte la vie des autres, pas la tienne. »
Pour le dire au plus simple, il est rare que notre vécu soit incroyable ou ridicule d’un bout à l’autre de la journée. Il n’est donc pas possible de mettre ce type de réaction émotive sur le compte de la peur de ne pas être cru sur parole ou sur cette autre peur de voir les autres se moquer de nous. Il y a donc forcément autre chose de caché sous ce silence maladif. Sans doute la pire chose que le subconscient se refuse de voir ressurgir. Une réalité. Cette réalité se nomme « Tout le monde se moque éperdument de ta vie, seule compte la vie des autres, pas la tienne. »
 Mais dans ce cas, que dire de celles et de ceux qui se vident carrément et compulsivement, quand on fait mine de vouloir leur prêter attention ? La cause est identique, la réaction à cette cause seule diffère. Ceux qui n’ont pas été écouté se découragent le plus souvent de se livrer. Mais certains n’en peuvent plus à force de tout garder pour eux. Alors ils se vident, tout en étant persuadés que personne ne les écoute vraiment et de toute manière ! D’autres encore réagissent plus violemment et refusent catégoriquement qu’on leur manque de respect (selon eux) en ne leur offrant pas assez attention. Ces gens-là se reconnaissent au fait qu’ils exigent, parfois avec violence verbale ou autre, qu’on leur prête non pas seulement attention, mais bien que toute l’attention humainement possible soit réquisitionnée pour eux, qu’elle leur soit entièrement allouée, en somme.
Mais dans ce cas, que dire de celles et de ceux qui se vident carrément et compulsivement, quand on fait mine de vouloir leur prêter attention ? La cause est identique, la réaction à cette cause seule diffère. Ceux qui n’ont pas été écouté se découragent le plus souvent de se livrer. Mais certains n’en peuvent plus à force de tout garder pour eux. Alors ils se vident, tout en étant persuadés que personne ne les écoute vraiment et de toute manière ! D’autres encore réagissent plus violemment et refusent catégoriquement qu’on leur manque de respect (selon eux) en ne leur offrant pas assez attention. Ces gens-là se reconnaissent au fait qu’ils exigent, parfois avec violence verbale ou autre, qu’on leur prête non pas seulement attention, mais bien que toute l’attention humainement possible soit réquisitionnée pour eux, qu’elle leur soit entièrement allouée, en somme.
 Ces derniers vivent très mal la moindre seconde d’inattention ou même de lassitude et guettent adroitement toute velléité de détourner l’attention et donc, le regard. Ils exigent très souvent qu’on les regarde en face quand ils nous parlent et savent lancer des propos blessant ou humiliant pour forcer les autres à se concentrer pleinement sur eux. Il existe diverses manières de réagir, une fois atteint l’âge adulte, au manque d’attention ou même d’intérêt des géniteurs, durant l’enfance. Mais les quatre plus connues et usitées, de nos jours, sont :
Ces derniers vivent très mal la moindre seconde d’inattention ou même de lassitude et guettent adroitement toute velléité de détourner l’attention et donc, le regard. Ils exigent très souvent qu’on les regarde en face quand ils nous parlent et savent lancer des propos blessant ou humiliant pour forcer les autres à se concentrer pleinement sur eux. Il existe diverses manières de réagir, une fois atteint l’âge adulte, au manque d’attention ou même d’intérêt des géniteurs, durant l’enfance. Mais les quatre plus connues et usitées, de nos jours, sont :
1. L’indifférent. Qui n’a pas supporté, justement, l’indifférence qu’on lui a témoigné jadis. Il est si persuadé qu’on ne s’intéresse pas à lui qu’il élude, plus ou moins consciemment, tout ce qui pourrait justement intéresser autrui à son sujet. C’est sa manière très enfantine de « se venger », cela en privant les autres de ce qu’ils l’ont privé à lui et au préalable.
2. L’expansif. A l’inverse de tous les autres, il adore se raconter. Du moins est-ce là l’impression qu’il donne voire qu’il souhaite donner. Mais si on y fait attention, ses propos sont sans importance, voire vite lassant, car sans grand intérêt. Surtout pour autrui ! Et l’expansif le sait pertinemment, mais c’est sa double manière de « vider un trop plein » et de « punir » ceux qui, jadis, ne lui témoignèrent pas l’attention qu’il méritait. C’est la personne qui croisée au détour d’un chemin, commence à « nous raconter sa vie », comme on dit, et ne nous lâche plus, feignant de ne pas voir qu’elle nous lasse ou que nous sommes pressés (par exemple.)
3. L’interrogateur. Qui adore questionner dans l’espoir d’attirer puis de maintenir l’attention d’autrui, afin de compenser le même manque issu de la prime enfance. Généralement, on décèle soit la présence de frères ou sœurs aînés, soit l’indifférence d’un proche admiré ou simplement aimé. Souvent, l’interrogateur est devenu fin psychologue et sait réquisitionner, de force, l’attention de ses pairs. Quitte à se montrer allusif ou carrément insultant, par exemple.
4. L’agressif. Qui exige qu’on lui témoigne du respect, cela par le biais d’une attention totale et sans faille. Peu être violent s’il n’obtient pas ce qu’il souhaite. Pour lui, l’attention et l’intérêt lui sont choses dues et il ne permet à personne d’être « volé » à ce sujet.
 Il est assez facile de savoir si nous sommes entourés de proches atteints de cette maladie de l’âme moderne. Il suffit d’attendre de savoir si quelque chose sortant un peu de l’ordinaire est arrivé à un proche puis de lui demander si tout va bien, s’il n’a rien à vous raconter, etc. Si la personne est affectée de ce mal redoutable, car générateur de conflits en tous genres (surtout dans le couple), elle va éluder ou orienter la discussion sur des sujets sans importance. Mais la manière dont elle esquivera le sujet, dépendra des mécanismes de défense installés durant la prime enfance, voire juste aux débuts de l’adolescence.
Il est assez facile de savoir si nous sommes entourés de proches atteints de cette maladie de l’âme moderne. Il suffit d’attendre de savoir si quelque chose sortant un peu de l’ordinaire est arrivé à un proche puis de lui demander si tout va bien, s’il n’a rien à vous raconter, etc. Si la personne est affectée de ce mal redoutable, car générateur de conflits en tous genres (surtout dans le couple), elle va éluder ou orienter la discussion sur des sujets sans importance. Mais la manière dont elle esquivera le sujet, dépendra des mécanismes de défense installés durant la prime enfance, voire juste aux débuts de l’adolescence.
Si la personne demeure évasive, feint l’indifférence, etc., cela signifie qu’elle a souffert du manque d’attention de ses parents durant son enfance, mais qu’elle préfère le cacher et ne pas avoir à faire face à cette problématique. Si la personne réagit en affichant l’intention de s’emparer du processus (par exemple en vous interrogeant, en se montrant méfiante, agressive, etc.,) cela signifie qu’elle a bien sur souffert de ce même manque d’attention, mais qu’elle tient à le faire savoir au monde entier et surtout, à ses proches.
 Il serait tentant d’en conclure que les gens qui éludent ou se défendent mollement d’avoir quelque chose à raconter sur leur propre vécu, sont les personnes les plus faciles à vivre et donc, à côtoyer. Ce qui transforme les seconds, plus ou moins compulsifs et donc, plus ou moins agressifs, en des personnes difficilement fréquentables. Mais en réalité, le problème d’origine étant identique et même si la réaction à cette problématique diffère du tout au tout, ce sont les deux types de mécanismes de défense qui sont difficiles à vivre et donc, à accepter, pour toute personne qui n’est pas affectée par cette souffrance intime. Cela parce que, justement, il ne s’agit plus alors de mécanismes de défense, mais bien de mécanisme de domination ! La différence entre les deux étant de taille, du moins pour toute personne connaissant la psychologie comportementale.
Il serait tentant d’en conclure que les gens qui éludent ou se défendent mollement d’avoir quelque chose à raconter sur leur propre vécu, sont les personnes les plus faciles à vivre et donc, à côtoyer. Ce qui transforme les seconds, plus ou moins compulsifs et donc, plus ou moins agressifs, en des personnes difficilement fréquentables. Mais en réalité, le problème d’origine étant identique et même si la réaction à cette problématique diffère du tout au tout, ce sont les deux types de mécanismes de défense qui sont difficiles à vivre et donc, à accepter, pour toute personne qui n’est pas affectée par cette souffrance intime. Cela parce que, justement, il ne s’agit plus alors de mécanismes de défense, mais bien de mécanisme de domination ! La différence entre les deux étant de taille, du moins pour toute personne connaissant la psychologie comportementale.
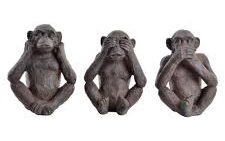 Se taire est devenu, pour beaucoup, un moyen de conserver « un certain pouvoir » sur autrui. Généralement un proche. Ne pas tout révéler de soi est considéré, de nos jours, non seulement comme étant plus prudent mais encore, quasi indispensable. Du moins si on désire « conserver le contrôle.» Un contrôle que, bien évidemment, on n’a jamais possédé ! Car le désir de possession, en toute logique, ne peut s’appliquer qu’à ce qui nous manque, jamais à ce que nous possédons déjà. Seuls les pauvres parlent sans cesse d’argent, c’est bien connu également. Mais laissons déjà les lecteurs méditer plus avant, et par eux-mêmes, sur ces quelques considérations que nous jugeons précieuses pour comprendre un des nombreux aspects difficiles à cerner du comportement humain.
Se taire est devenu, pour beaucoup, un moyen de conserver « un certain pouvoir » sur autrui. Généralement un proche. Ne pas tout révéler de soi est considéré, de nos jours, non seulement comme étant plus prudent mais encore, quasi indispensable. Du moins si on désire « conserver le contrôle.» Un contrôle que, bien évidemment, on n’a jamais possédé ! Car le désir de possession, en toute logique, ne peut s’appliquer qu’à ce qui nous manque, jamais à ce que nous possédons déjà. Seuls les pauvres parlent sans cesse d’argent, c’est bien connu également. Mais laissons déjà les lecteurs méditer plus avant, et par eux-mêmes, sur ces quelques considérations que nous jugeons précieuses pour comprendre un des nombreux aspects difficiles à cerner du comportement humain.
Serge Baccino
